Comment la BD s’est emparée de la Shoah

 Lieu de mémoire, de pédagogie et de transmission sur l’histoire du génocide des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, le Mémorial de la Shoah à Paris accueille depuis le 19 janvier, et jusqu’au 30 octobre 2017, une exposition sur la représentation du génocide dans la bande dessinée. Prolongeant notamment la conférence sur les super-héros (« Pourquoi les super-héros n’ont-ils pas libéré Auschwitz ? ») en présence de Chris Claremont (X-Men), Jean-Pierre Dionnet et l’historien Tal Bruttmann, l’exposition retrace un « parcours historique et artistique (…) en interrogeant les sources visuelles de ces représentations, leur pertinence, leur portée et leurs limites ». Car « non sans prudence, erreurs et tâtonnements, la BD s’est emparée de la Shoah ».
Lieu de mémoire, de pédagogie et de transmission sur l’histoire du génocide des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, le Mémorial de la Shoah à Paris accueille depuis le 19 janvier, et jusqu’au 30 octobre 2017, une exposition sur la représentation du génocide dans la bande dessinée. Prolongeant notamment la conférence sur les super-héros (« Pourquoi les super-héros n’ont-ils pas libéré Auschwitz ? ») en présence de Chris Claremont (X-Men), Jean-Pierre Dionnet et l’historien Tal Bruttmann, l’exposition retrace un « parcours historique et artistique (…) en interrogeant les sources visuelles de ces représentations, leur pertinence, leur portée et leurs limites ». Car « non sans prudence, erreurs et tâtonnements, la BD s’est emparée de la Shoah ».
Toutes les tendances de la BD sont convoquées, des comics au franco-belge en passant par le manga et le roman graphique, pour rappeler un fait majeur de l’Histoire et en interroger ses représentations. Quand les auteurs ont-ils commencé à s’emparer du sujet ? Dans quels contextes ? Avec quels parti-pris ? Et surtout, comment représenter l’ineffable et l’horreur ? Avec quels outils (satire, « rire grinçant », humour ?), motifs ou symboles ? Entre la transcription réaliste et des évocations artistiques, l’exposition tente de dresser un inventaire « des lignes de force » et « une grammaire » de ces narrations.

Ce sont donc en tout plus de 200 documents originaux qui sont présentés dans des salles ténues où la lumière éclaire avec pudeur quelques moments importants d’une petite histoire longue de 75 ans. C’est évidemment le chef-d’œuvre Maus (1986) d’Art Spiegelman qui consacre la Shoah dans la BD, montrant le 9e art comme un vecteur de mémoire. Mais bien avant, Calvo évoque pour la première fois la Shoah dans La Bête est morte ! (1944) alors que l’impuissance des super-héros se lit dans Superman, Captain America et le Spirit de Will Eisner.




C’est aussi Mickey au camp de Gurs de Horst Rosenthal, carnet réalisé pendant l’internement de l’auteur avant son gazage à Auschwitz, ou Master Race, signé Krigstein, qui aborde la Shoah à travers les souvenirs des camps de concentration d’un Allemand réfugié aux États-Unis après la guerre. Délaissant le réalisme, Krigstein a lui une ambition d’artiste : encrage lugubre, plans de cinéma, compositions chargées de symboles et d’icônes visuelles, il montre lui aussi tout le potentiel de la BD.


Le manga n’est pas en reste avec L’Histoire des 3 Adolf (1983) par Osamu Tezuka, seul exemple connu en BD d’un récit de la Shoah narré par un Japonais, qui met en parallèle l’histoire du Japon et celle de l’Allemagne. Une BD d’ailleurs héritière du célèbre feuilleton américain Holocaust (1978).

Dans les dernières salles, l’exposition met en lumière les BD qui ont d’une manière ou d’une autre abordé la question. Sous l’angle juridique avec Crimes de papier (Johanna Sebrien et Jean-Baptiste B.) ou historique avec Café Budapest d’Alfonso Zapicone, qui remonte aux origines de la création de l’Etat d’Israël.







D’une grande richesse, originale et plus que jamais nécessaire, cette exposition qui montre comment un art réputé « mineur » s’est emparé avec créativité d’un moment de l’histoire douloureux, est bien sûr à ne pas manquer. Pour se souvenir et surtout réfléchir. Salutaire.
_________________________
Exposition Shoah et bande dessinée.
Du 19 janvier au 30 octobre 2017 au Mémorial de la Shoah à Paris, entrée libre.
_________________________




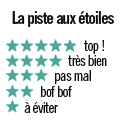
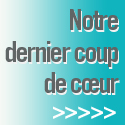

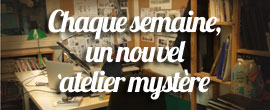
Publiez un commentaire